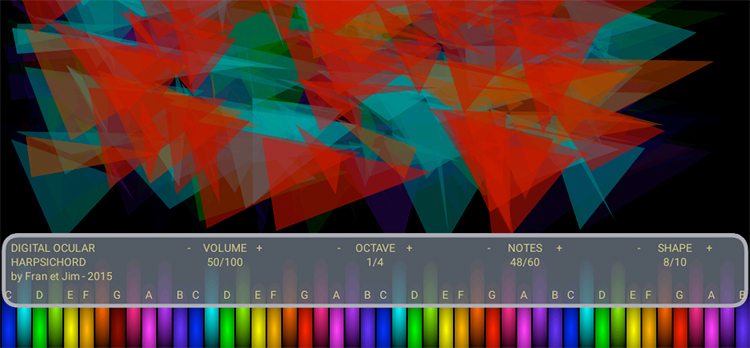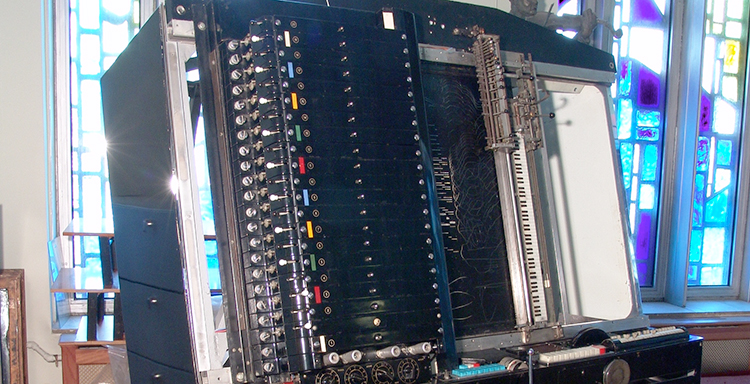De la tulipe à la crypto marguerite
Deux récents évènements viennent donner un relief singulier à l’exposition d’œuvres axées sur les crypto-monnaies qui se tient jusqu’au 20 mars à l’Avant Galerie Vossen dans le 3e à Paris. Tout d’abord l’intérêt renouvelé du fantasque Elon Musk (Tesla, Space X) pour le Bitcoin, et dans une autre mesure le Dogecoin, entraînant dans son sillage de nombreux remous financiers. Ensuite le récent « hold-up » de pirates boursicoteurs, réunis sur un forum du site communautaire Reddit qui ont jeté leur dévolu sur les actions de la chaîne de jeu vidéo américaine Gamestop, contrecarrant ainsi le plan des loups de Wall Street, torpillant des fonds d’investissement et obligeant les autorités financières, dépassées cette rébellion 2.0, à bricoler en urgence de nouvelles règles du marché…

Les crypto-monnaies et les échanges financiers appliqués au monde de l’art sont donc au cœur de cette exposition qui retrace aussi, comme son intitulé le laisse deviner, l’histoire de la spéculation. C’est en effet autour de la tulipe, plus exactement du commerce de ses bulbes, que s’est cristallisé le premier phénomène spéculatif de l’histoire. Nous sommes en Hollande bien évidemment, au XVIIe siècle, lorsque la machine se met en branle. Rapidement les prix s’envolent jusqu’à atteindre des valeurs stratosphériques : à l’apogée de cet emballement « hors sol », un bulbe vaut l’équivalent d’une ou deux maisons ou quinze ans de salaire d’un artisan. Et ce qui devait arriver, arriva : le cours de la tulipe s’effondre en quelques semaines, en 1637, dans un pays par ailleurs ravagé par la peste bubonique…
Autre temps, autre épidémie. Depuis, ce scénario s’est répété, amenant à chaque fois des variantes, renouvelant l’expérience avec une multitude de denrées, de ressources, de produits, de titres… Mais le symbole de la tulipe est resté et de nombreux artistes réunis ici ont pris cette fleur comme sujet, soulignant selon les supports, matières ou protocoles mis en œuvre, la vacuité et la fragilité de ces acrobaties financières. C’est le cas, pêle-mêle, de Louise Belin (Tout doit disparaître), de Mona Oren (Wax Tulip Mania, un parterre de tulipes en cire noire et blanche), du bien nommé Denis Monfleur ou d’Anna Ridler (Mosaic Virus, une installation vidéo dont l’extrait du dataset présenté ici offre un aperçu des milliers de polaroïds qu’elle annote scrupuleusement et qui servent aussi de base de données pour l’apprentissage algorithmique de… la reconnaissance de la tulipe).

D’autres œuvres, relevant ou non de l’art numérique, partent sur d’autres pistes à l’exemple de Prosper Legault et son enseigne qui joue sur la duplicité sémantique du mot « change » (échange / changement), alignant sur le côté un inventaire à la Prévert qui se déroule comme la promesse « bonnes résolutions » (« Change » de sexe, de quartier, de mentalité, de climat, de crèmerie, de curateur, d’argent…). En 2014, la revue MCD avait justement publié un numéro intitulé Changer l’argent. Détail : à l’époque, 1 Bitcoin cotait seulement 400€… En parallèle du crypté et du virtuel, il y était aussi question de « fausses monnaies » plus vraies que nature quant à leur raison d’être (Agliomania, Gibling, Livre Lewes, Knochen, Afro…).
Jade Dalloul avec sa série Brand Currency — qui reprend les codes graphiques des billets de banque en substituant comme illustration le logo de grands groupes avec leurs patrons en effigie — s’inscrit parfaitement à la suite de ces démarches artistiques générant des utopies monétaires. Ce qui a vraiment changé, par contre, depuis la publication de cette édition, c’est bien la place du marché. Plus précisément, la question de l’achat et de la vente d’une œuvre d’art numérique ; question centrale avec, à l’autre bout du spectre, la problématique de la conservation.

Jade Dalloul, Brand Currency. Photo: D.R
Une œuvre d’art numérique pouvant être un objet « dématérialisé » (un simple fichier dans le cas du net-art par exemple) et/ou être reproductible à l’infini, alors que pour l’Ancien Monde la valeur financière est indexée au caractère unique et à la possession physique, cela invite forcément à une redéfinition des conditions de transaction. L’arrivée des crypto-monnaies offre, spécifiquement pour l’art numérique, une solution adaptée. L’idée n’est pas tant d’acheter des œuvres avec des Bitcoins ou autres, même si cela est désormais possible dans de nombreux lieux — à commencer, logiquement, par l’ Avant Galerie Vossen où se tient cette exposition — mais de transposer et d’appliquer la technologie du blockchain à une œuvre d’art.
Le code algorithmique (blockchain) assure l’identité, l’authenticité et la propriété de l’œuvre. C’est cela que l’on achète et non pas l’œuvre elle-même qui peut ainsi continuer à être dupliquée sans perdre, pour l’acheteur, son caractère unique et sa valeur. La certification de l’algorithme la rend non-interchangeable. Par définition, cela devient un bien non-fongible (NFT, non-fongible token). Traçables grâce au blockchain, les œuvres virtuelles ou dématérialisées subissent ainsi un processus de réification qui permet aussi des reventes (le fameux marché secondaire) tout en assurant un pourcentage systématique sur la transaction à l’artiste. Ce droit de suite (un peu l’équivalent des royalties) étant automatiquement implémenté avec le blockchain.
Nous assistons en fait à la naissance du « crypto-art », dont les babillements datent seulement de quelques années. Les premières transactions de ce genre remontent notamment aux CryptoKitties, les chats virtuels échappés du jeu en ligne éponyme en 2017. Et à en juger par les points rouge présent sur bon nombre d’œuvres présentées à cette exposition, cette expérience transactionnelle séduit. Qui plus est, l’artiste Albertine Meunier propose chaque samedi, sur inscription, un atelier historique et pratique sur le crypto-art. Une conférence animée par Victor Charpiat est également prévue sur ce thème. Satoshi Nakamato, le père putatif du Bitcoin dont le portrait peint par Ronan Barrot orne les murs de la galerie, doit sourire derrière son écran…
Laurent Diouf
De la tulipe à la crypto marguerite
atelier (Albertine Meunier) + conférence (Victor Charpiat) + exposition avec Allbi, Bananakin, Robbie Barrat, Ronan Barrot, Louise Belin, Bleh, Fernando Botero, Bady Dalloul, Jade Dalloul, DataDada, Norman Harman, Denis Laget, Prosper Legault, Lulu xXX, Albertine Meunier, Denis Monfleur, Mona Oren, Paul Rebeyrolle, Anna Ridler, Robness, Milène Sanchez, Sylvie Tissot…
> jusqu’au 20 mars, Avant Galerie Vossen, 58 rue Chapon, 75003 Paris
(mercredi / samedi, 14h30 / 17h30)
> https://avant-galerie.com/



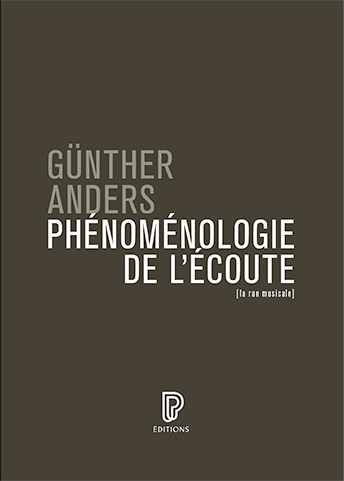


 But psychedelic music is where SF has most potential in the Spinrad sense of perception. First off, there is the Pink Floyd spaceship piloted by Syd Barrett who delivers titles sparkling with stars and scented with acid and marijuana, such as Astronomy Domine, Interstellar Overdrive and Set the Control for the Heart of the Sun, as well as the whole “Krautrock” constellation (German rock of the 1960s and ’70s) with the representatives of the “cosmiche musik” trend: Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear) or Klaus Schultze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune), whose album titles evoke interstellar cargo-crossed immensities and more or less exotic planets that were already celebrated by Gustave Holst in his time. But whereas the British composer’s music only fully functioned as illustration once the theme was announced, all it took was a few notes for the cosmiche rockers to propel us into space.
But psychedelic music is where SF has most potential in the Spinrad sense of perception. First off, there is the Pink Floyd spaceship piloted by Syd Barrett who delivers titles sparkling with stars and scented with acid and marijuana, such as Astronomy Domine, Interstellar Overdrive and Set the Control for the Heart of the Sun, as well as the whole “Krautrock” constellation (German rock of the 1960s and ’70s) with the representatives of the “cosmiche musik” trend: Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear) or Klaus Schultze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune), whose album titles evoke interstellar cargo-crossed immensities and more or less exotic planets that were already celebrated by Gustave Holst in his time. But whereas the British composer’s music only fully functioned as illustration once the theme was announced, all it took was a few notes for the cosmiche rockers to propel us into space. This music that we do not perceive, but that exists somewhere in the mathematical universe of the world, do we not hear it somehow in the soundtrack of Eraserhead as “interpreted” by David Lynch and Alan Splet? It seems that this reinvented music of matter, of time and of space is, according to Spinrad’s definition, unquestionably science-fiction music, just like the images that go with it.
This music that we do not perceive, but that exists somewhere in the mathematical universe of the world, do we not hear it somehow in the soundtrack of Eraserhead as “interpreted” by David Lynch and Alan Splet? It seems that this reinvented music of matter, of time and of space is, according to Spinrad’s definition, unquestionably science-fiction music, just like the images that go with it.