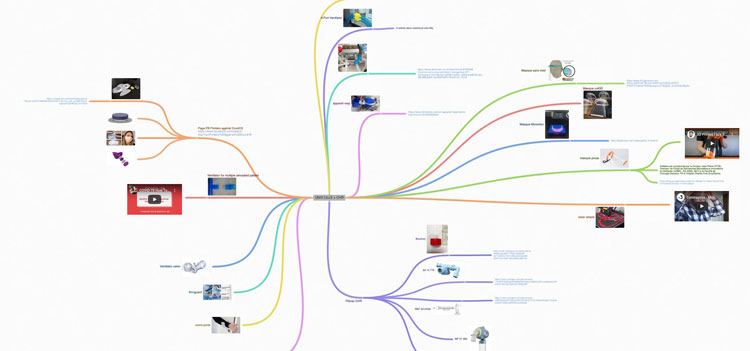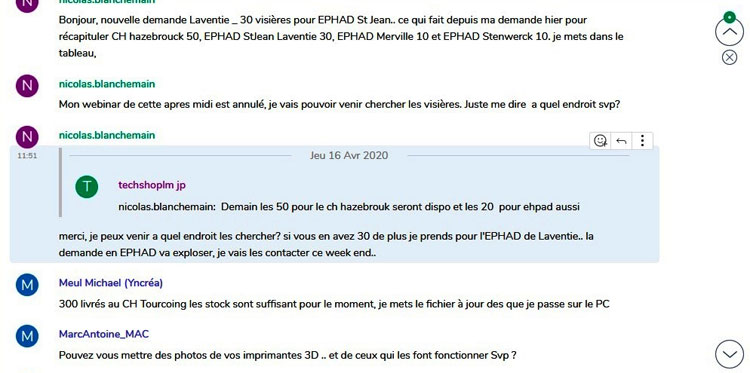et autres initiatives de makers à Lomé
Depuis un an Isabelle Arvers est engagée dans un tour du monde à la rencontre des pratiques de femmes, féministes, queer et décoloniales dans le domaine du jeu vidéo. Corée, Taïwan, Indonésie, Japon, Thaïlande, Inde, Brésil, Argentine, Colombie, Ghana… et puis mars et le confinement planétaire sont arrivés, au moment où Isabelle Arvers arrivait au Togo. Entre expérience de la pandémie et rencontres inattendues, seconde partie de sa correspondance depuis Lomé.

Isabelle Arvers (premier rang, au centre) à la Case des Daltons. Photo: D.R.
Les Woelabs lieux de démocratie technologique
L’interview de Sename Koffi, commissaire de l’exposition « Lomé + » chroniquée dans ma première correspondance m’a fait appréhender tout l’écosystème numérique togolais. En l’interviewant, je découvre les premiers fablabs créés à Lomé, mais aussi comment ces lieux sont devenus un tech hub et ont initié plusieurs générations de makers.
Le Woelab est un projet initié par Sename Koffi Agbodjinou en 2012 avec la création d’un premier espace, le Woelab Zéro, puis d’un second, le Woelab Prime en 2016. Dans l’idée de « mailler tout le territoire d’espaces d’innovation avec un réseau de lieux, en essayant d’avoir un lieu dans chaque quartier. Les deux lieux se situent à la frontière du Ghana, afin de transformer cette bande frontalière en un « smart territoire ». Woelab est l’équivalent Togolais du fablab, puisque « Woe » signifie « fais-le » en Ewé.
C’est un laboratoire pour faire des choses, un espace dédié au numérique, un lieu transversal. Avec des espaces de coworking proposant des services partagés (aide juridique, secrétariat, communauté, programme d’accompagnement des entrepreneurs, reprographie, comptabilité) ; un incubateur de start-up avec un accompagnement à la professionnalisation d’entreprise ; un lieu d’apprentissage des technologies et aujourd’hui un grenier urbain grâce à la start-up Urbanattic.
Sename m’explique que « c’est un projet qui a un peu déclenché la scène tech au Togo, on a créé le premier tech hub du pays et toutes les choses en lien avec le digital ont ensuite gravité autour. » En 8 ans, de très nombreuses personnes sont passées par les Woelabs, de nombreuses sociétés se sont créées. L’idée étant de former des personnes aux nouvelles technologies pour qu’elles puissent ensuite produire elles-mêmes leurs propres techno. « Dans la scène tech togolaise, 4 personnes sur 5 viennent de chez nous. » Le Woelab a d’ailleurs été sous le feu des projecteurs en 2013 pour avoir conçu la W.Afate, la toute première imprimante 3D créée à partir de déchets électroniques. Un projet qui avait été primé par la NASA dans le cadre de l’International Space Apps Challenge.

Quartier Woelab. Photo: D.R.
Les Woelabs sont des lieux majoritairement fréquentés par des jeunes, la moyenne d’âge allant de 13 à 19 ans. Le profil des jeunes n’est pas forcément « tech ». « L’engagement de ce lieu, poursuit Sename, est de prouver que n’importe qui, même quelqu’un qui n’a pas été à l’école, peut devenir une personne qui a complètement compris ce qu’est la culture digitale et est capable de faire des choses avec le numérique. Toute personne qui souhaite apprendre est la bienvenue, il n’y a aucun filtrage, aucune sélection. On se présente comme des espaces de démocratie technologique. »
Les labs sont en capacité d’accueillir chacun une trentaine de jeunes, donc chaque année une communauté se stabilise autour de 60 jeunes. En début d’année, il est demandé à chaque jeune ce qu’il ou elle aimerait réaliser et ils/elles vont ensuite pouvoir suivre les ateliers et différentes interventions de professionnels dans des domaines aussi variés que le dessin technique, la modélisation 3D, le code, le prototypage, etc. Chaque intervention étant destinée à accompagner le projet de chacun.e dans le cadre des WoecodeAcademy, « un programme d’activation junior ».
D’autres interventions sont proposées dans le cadre de la Woe Academy, une sorte d’université libre, ouverte au tout public, qui m’a permis de donner trois ateliers machinima en ligne via zoom à la communauté des Woelabs. Pour le dernier atelier, j’étais accompagnée par les jeunes de la Opencode Academy. 8 ans après sa création, avec près de 60 jeunes qui viennent tout au long de l’année, on peut imaginer le nombre de personnes que ces lieux ont pu toucher et faire évoluer.

Atelier machinima au Woelab. Photo: D.R.
Trouver des solutions pour l’environnement immédiat
C’est Mabizaa Badanaro, mathématicien et économiste de formation et « catalyseur » de la communauté web de tout cet écosystème, qui me reçoit au Woelab Zero et me rappelle les fondements du lieu : « Avec les Woelabs on souhaite créer un modèle d’urbanisme participatif qui contribue à développer des services pour simplifier la vie des populations africaines : nourriture, éducation, mobilité, santé, environnement… en développant des solutions sur des problématiques concrètes. 3 personnes sur 5 en Afrique n’ont pas accès à internet. Aussi, ce que nous souhaitons avec Woelab, c’est combler ce fossé technologique. »
Trois projets en mode start-up sont actuellement accompagnés par Woelab. Tout d’abord, WoeBots, la start-up qui tire son nom de l’imprimante 3D inventée par Kodjo Afate Gnikou, la W.Afate. Imaginée pour donner la capacité au plus grand nombre de produire des objets en 3D et pouvoir ainsi sortir de « leur isolement technologique ». La W.Afate a été la première imprimante 3D réalisée à partir de déchets électroniques en Afrique, Kodjo a ensuite travaillé pour renforcer son imprimante, la rendre plus robuste et aujourd’hui la W.Afate n’est plus conçue à partir de déchets électroniques, mais à partir de composants, afin de pouvoir la produire en série. Actuellement, dans le but de démocratiser l’accès à la conception d’objets en 3D, l’idée est de donner à chaque école africaine une imprimante 3D et de former les professeurs puis les élèves, afin d’ apprendre à modéliser des objets puis à les imprimer.

Urbanattic. Photo: D.R.
Urbanattic est une plateforme en ligne qui gère des greniers urbains connectés, chargés de produire de l’alimentation bio dans Lomé et d’implanter des greniers dans chaque quartier afin de promouvoir l’agriculture bio, le circuit court et de prodiguer de la nourriture bio aux populations. « Vous valorisons aujourd’hui, autour des WoeLabs Zéro et Prime, cinq potagers issus de la transformation de dépotoirs sauvages. » L’autre mission d’Urbanattic est de former la population à l’agriculture et à l’alimentation responsables en ville, afin de créer d’autres greniers dans la ville et de transformer les habitudes de consommation : il y a des ateliers d’aquaponie, de confitures, de diététique, etc. Les potagers sont équipés de capteurs de taux d’humidité et bientôt seront aussi équipés de capteurs de pH.
Les objets connectés font aussi partie de SCoPE, « Sorting and Collecting Plastics for our Environment ». Une société dédiée au recyclage des déchets, créée afin de sensibiliser les gens à ne pas jeter partout leurs ordures. « On a construit des kits pour recevoir tous les produits recyclables. Nous développons actuellement un capteur capable d’indiquer quand le kit est rempli afin qu’il puisse être enlevé par l’équipe. Nous déposons ces kits chez les habitants et venons les relever lorsque ceux-ci sont pleins. » Les sacs qui réceptionnent tous les objets recyclables sont eux-mêmes conçus à partir de petits sacs plastiques recyclés. Des sacs que l’on voit partout dans les rues ou sur les rivières, car ce sont les sachets d’eau que les gens boivent au quotidien. De l’eau du robinet mise sous sachet plastique et ensuite rafraîchie.
Sename est le fondateur et le gestionnaire du lieu. Il forme les jeunes et auto-finance également entièrement les Woelabs. « D’abord au départ par pure radicalité, puis lorsqu’on s’est ouvert à des sponsors, les choses ont pris du temps et ne sont pas forcément venues. »

Le lavabo intelligent de Kokou Sitsope Sekpona. Photo: D.R.
Depuis d’autres incubateurs et makerspaces ont fleuri au Togo :
Tout d’abord l’Ecoteclab. Je rencontre Ousia A. Foli-Bebe, le fondateur d’Ecoteclab au Nunyalab, un nouvel incubateur et espace de coworking, mis en place par le gouvernement togolais pour accompagner le jeune entrepreneuriat. Ousia a étudié l’environnement et la qualité de vie, ainsi que les énergies renouvelables, dans le but de produire de la technologie pour le milieu agricole. « Premier problème, je n’avais pas de lieu qui pouvait m’accompagner pour produire les machines que j’imaginais, il n’y avait pas d’endroit où on pouvait faire ça. »
C’est dans cette recherche de lieux qu’il est passé par le Woelab, pendant 9 mois, entre 2013 et 2014. Mais les équipements manquaient pour son projet. C’est là qu’il a décidé de créer son propre makerspace. L’Ecoteclab a démarré en sept 2016, également sur une base d’autofinancement, sauf pour le lieu d’accueil, occupé à titre gracieux. Même les ateliers sont dispensés gratuitement. « On a pensé à donner des formations payantes, mais notre public n’en a pas les moyens, alors nous facturons des prestations payantes à des entreprises ou à des structures publiques. »
MoLab, un projet initié par l’ambassade américaine, mais qui se poursuit à présent de façon autonome, est un maker bus, alimenté en énergie solaire, conçu et à présent géré par Ecoteclab. Le Molab sillonne le pays pour donner des formations et des ateliers aux publics jeunes. Un bus conçu pour se déplacer dans les écoles et faire le lien entre connaissances théoriques et fabrication de prototypes, et faire découvrir les compétences que l’on peut développer avec le numérique.
« Notre but est d’inciter les jeunes à devenir des makers et des inventeurs. Pour y parvenir, on leur donne des exemples concrets d’innovateurs sur la scène togolaise : comme le Foufoumix. Une machine pour piler le foufou, le plat national togolais fabriqué à partir d’igname pilé, inventée par le Togolais Jules Minsob Logou il y a dix ans, après avoir observé les femmes de sa famille s’épuiser à la tâche. Souvent on va dans des villages où les écoles n’ont pas de bâtiments en dur, ça fait trois ans que le Molab circule, et ce, dans toutes les régions du Togo, même dans des endroits privés d’électricité. »

Ousia et ses visières. Photo: D.R.
La réponse des makers togolais à la Covid-19
Au début de la crise du Covid, Ousia s’est rapproché d’autres makers et en particulier du nouveau makerspace de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Lomé et ils ont réfléchi à la manière de trouver des solutions à la pandémie. Ils ont d’abord commencé à produire des visières. Puis ils ont imaginé un respirateur. Ils ont alors créé un premier prototype, mais comme c’est un équipement médical il a fallu passer par toute une série de validations. « Pour nous, le plus important c’est que les gens comprennent ce que peuvent apporter les makers à la communauté. Quand on parle de robot, d’imprimantes 3D, les gens ne voient pas concrètement ce que l’on peut apporter, mais quand la crise est venue, les gens ont compris qu’on pouvait produire des choses localement, qu’on pouvait être utiles. »
Je retrouve Ousia à la Case des Daltons dans le cadre de Kantata, un projet de mémoire virtuelle de l’art vivant togolais initié lors du hackathon #touscontrecorona, une initiative privée qui a ensuite été portée par le gouvernement et la GIZ (l’agence de coopération internationale allemande pour le développement, NDLR). La Case se prépare en effet à accueillir un réseau local Raspberry Pi qui permettra aux artistes de se rencontrer afin de produire et de diffuser leurs contenus numériques.
Pour pouvoir respecter les gestes barrière, on nous incite à utiliser un lavabo mobile intégré à une poubelle jaune. Muni d’un capteur à infra-rouge, ce « lavabo intelligent » a été conçu chez lui par un jeune maker de 19 ans, étudiant en mécanique : Kokou Sitsope Sekpona. Il n’en est pas à sa première invention puisque il est en train de finaliser un générateur capable de fonctionner de manière autonome à l’énergie solaire, afin d’équiper en électricité les villages, même les plus reculés.
Les makers sont nombreux, le Togo peut s’en enorgueillir ! Je suis à présent sur le départ du Togo, dans l’attente de la réouverture de l’aéroport de Lomé, dans l’espoir de pouvoir reprendre mon tour du monde là où j’avais été arrêtée par la pandémie, avec si j’y parviens comme prochaine destination : le Kenya.
Isabelle Arvers
publié en partenariat avec Makery.info
Retrouvez la première partie de la correspondance d’Isabelle Arvers au Togo.
En savoir plus sur le tour du monde art et jeu vidéo d’Isabelle Arvers.