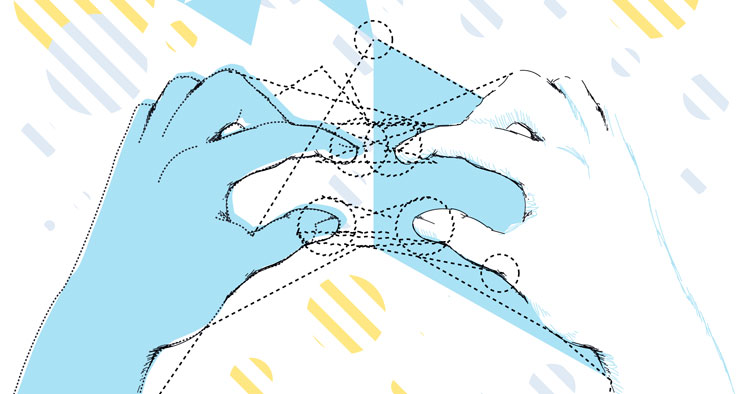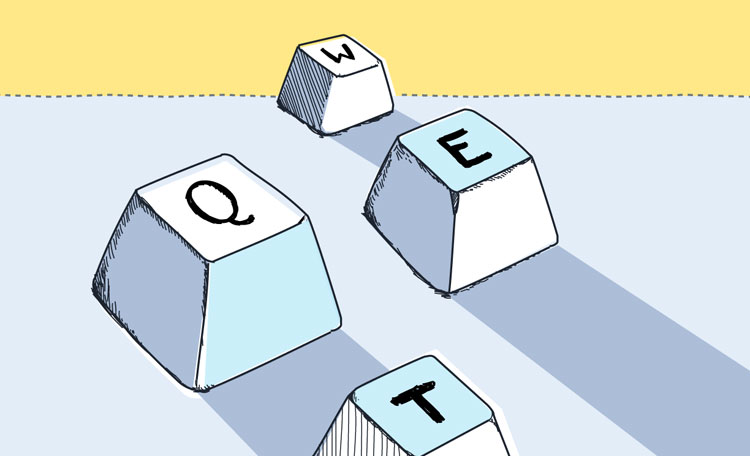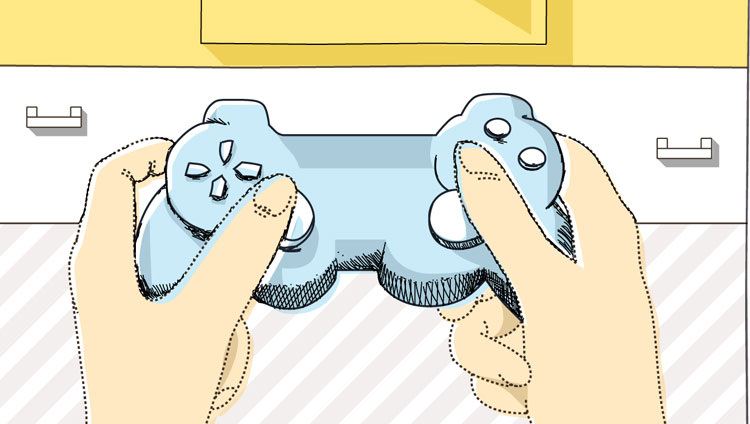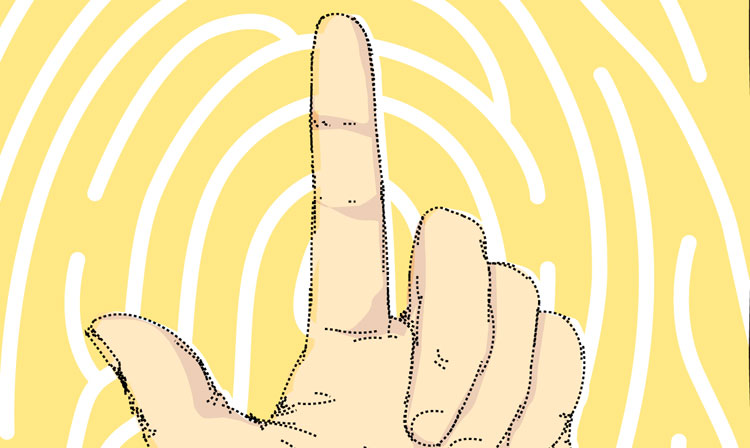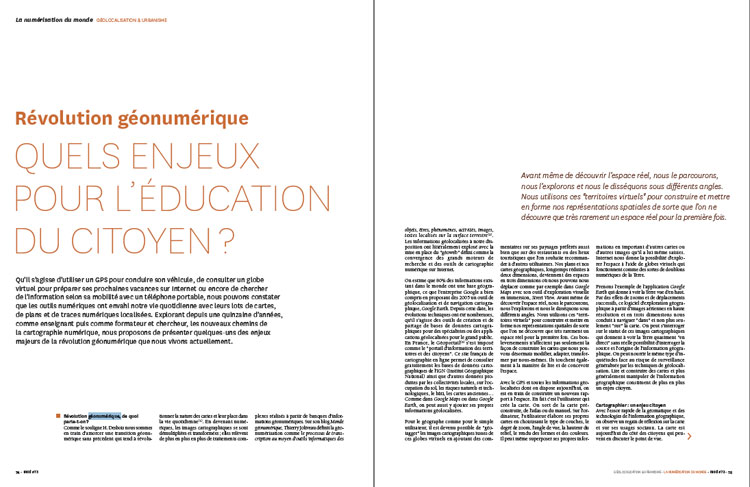Si l’on considère l’évolution de la sculpture dans l’art contemporain, on est conduit au constat d’une diversité croissante de propositions artistiques qui semblent s’être affranchies de toute référence à un modèle dominant, comme c’était encore le cas au temps des avant-gardes. On serait même conduit à penser que c’est là un phénomène constant dans l’histoire récente : de la statuaire venant ponctuer les abords des édifices publics ou religieux jusqu’à la sculpture moderne venant questionner dans l’espace public les excès même du modernisme, en passant par toutes les formes plus ou moins pérennes ou plus ou moins éphémères des arts du site et de l’environnement, la relation entre l’art et la ville s’est enrichie, diversifiée, et comme affranchie des limites de plus en plus incertaines qui séparent l’art et le non-art, le matériau et l’immatériau, l’urbain et le rurbain.
Ce mouvement est pour une large part l’effet de ce soupçon généralisé qui gouverne aujourd’hui la relation entre l’art et la réalité, et cette supposée déréalisation du monde à laquelle l’excès des simulacres et des simulations nous a accoutumés (1). On peut y voir, aussi et d’abord, la manifestation directe de l’importance prise par les questions de temporalité et de rythme, de mobilité et de trajet, dans les arts du volume et de l’espace, dans les formes mêmes de la spatialité artistique actuelle. Mais aussi, et avec pas moins de force, l’expression des divers modes de dislocation de nos régimes spatio-temporels d’appartenance à nos territoires et à nos environnements urbanisés : conséquence évidente, c’est un lieu commun de le rappeler, de la mondialisation et de l’essor des réseaux numériques qui viennent se superposer au territoire réel comme une deuxième peau, et même infiltrer ce territoire, de manière à la fois — et paradoxalement — de plus en plus invasive et de moins en moins visible parce que de plus en plus naturalisée (pour Benjamin, il faut le rappeler ici, le stade de la seconde technique est le stade de la technique naturalisée).
Thierry Paquot évoque à ce propos l’hypothèse d’une technologie urbaine mondialisée qui environne l’environnement (2), élevant le territoire réel à la puissance d’un hyper-territoire avec lequel les anciens territoires sont sommés de composer — de se réinitialiser devrait-on presque dire ici — sous peine de disparaître de la scène mondiale. Il ne serait pas vain de s’interroger à ce sujet sur la propension actuelle de l’architecture à renouer ainsi avec la scénographie et le spectaculaire en général, et à se libérer corrélativement d’une certaine doxa fonctionnaliste venue du modernisme : la scénographia des Grecs, qui fut aussi la voie royale qu’emprunta l’architecture des origines jusqu’à la Renaissance pour occuper le premier rôle dans des arts, est à nouveau à l’œuvre avec les « starchitectes », et singulièrement dans le domaine des lieux dédiés aux arts comme les musées (Hugo emploie même, dans son célèbre chapitre de Notre Dame de Paris, « ceci tuera cela », l’expression d’un art tyran pour souligner cette hégémonie de l’architecture sur les autres arts, qui, dans le temple ou la cathédrale, les contient et les retient tous sous sa coupole, avant que ceux-ci ne s’émancipent).
Peut-être convient-il de s’appuyer à ce point sur quelques repères pour étayer l’analyse des questions de l’art contemporain et de la ville, et pour mesurer à quel point ces questions nécessitent d’être réactualisées. On se référera ici à une étude de François Barré, publiée en ouverture de l’ouvrage Œuvre et Lieu (3). Barré distingue plusieurs modes d’inscription de l’œuvre d’art dans l’espace public : la statuomanie, l’indépendance revendiquée de l’œuvre par rapport au contexte, ou au contraire la revendication de l’influence du lieu sur l’œuvre (c’est le cas des colonnes de Buren). Mais aussi, les esthétiques relationnelles, l’importance du récit et de l’histoire immanents aux œuvres, les fonctions de seuil et de passages assignés aux œuvres, etc.
De cet essai de typologie, on peut retenir l’hypothèse, toujours d’actualité, d’un conflit, d’une tension jamais résolue, ou d’une relation en constante mutation, entre l’architecture ou l’urbanisme issu de la modernité (et en particulier celui qui résulte de l’application ad nauseam de la Charte d’Athènes) et l’art. Face à ce purisme urbanistique, réducteur et niveleur, lui-même profondément lié à l’industrialisation du territoire et à sa standardisation appelée, comme tout produit industriel, par cette industrialisation même, les artistes ont cherché à exprimer la nécessité de l’excès, de l’irréductibilité du « message » de l’œuvre d’art à un standard, à un code, une norme ou une mesure, et à faire de la forme souvent dérangeante qui la soutient le lieu d’une question adressée au monde, là où l’architecture se devait au contraire d’apporter surtout des réponses : rappelons que le modèle architectural qui présidera à la rédaction de la charte d’Athènes se donne d’abord comme une réponse, un remède à apporter à ce corps malade qu’est devenu la grande ville.
Ce qui est en cause, c’est la critique d’une modernité à spectre large et surplombant qui entend régner sans partage sur le visible spatial à l’échelle mondiale, et c’est ce regard totalisant dont certaines œuvres veulent montrer l’envers au noir, le paysage de ruines que cette modernité porte en puissance dans son arrogance même. On trouve une expression esthétique parfois très pertinente de cette intention dans certaines œuvres relevant d’un romantisme tardif, et qui se réapproprient à l’âge contemporain le goût romantique des paysages de ruines. C’est un tel dispositif de fragmentation et de chaos romantique, appliqué à l’histoire contemporaine, qu’avait imaginé Hans Haacke avec son installation à la Biennale de Venise, Germania, de 1993, en cassant le carrelage du sol et en faisant déambuler les visiteurs sur les éclats de ce paysage de ruines (4).
L’art urbain serait alors comme l’autre de la culture industrielle de la modernité et des technologies de contrôle qui la soutiennent, de ses médias, de ses signes surmultipliés dans l’espace urbain saturé, et il trouvera en effet son expression dans les esthétiques du soupçon, du fragment, du chaos, de la contrainte ou de la participation; esthétiques dont certains artistes (du Land art ou de la performance) ou certains écrivains (de « l’écriture blanche » ou du Nouveau Roman jusqu’à Tel Quel) proposeront de nombreuses occurrences. Il faut souligner à quel point ces esthétiques sont travaillées par le démembrement du corps propre comme du corps social, esthétiques du défaut, du manque, du retrait, de la dérive, de la désynchronisation diégétique et du silence corrélatifs à l’excès même du visuel; excès du visuel qui se manifeste dans la mise en spectacle de la marchandise, dans le bavardage de la communication et de la consommation de masse. Pourtant, les relations entre l’art et l’architecture ou l’urbanisme modernes peuvent être pensées aujourd’hui dans un autre cadre que celui de ce réductionnisme fonctionnaliste auquel l’art aurait cherché à s’opposer.
C’est en particulier la ligne adoptée dans une étude récente par Patrice Maniglier sur la problématique de l’espace conçu et de l’espace perçu, en particulier telles quelles s’appliquent à une œuvre de deux artistes [Laetitia Delafontaine et Gregory Niel], intitulée Rosemary’s place. […/…] Maniglier souligne avec pertinence que ce renversement, qui fait de l’image, et même de l’image-temps-et-mouvement du cinéma, la matière première d’un espace d’abord perçu avant que d’être conçu, réactualise l’ancienne scénografia des Grecs, aux yeux desquels l’architecture n’avait pas seulement pour vocation de remplir certaines fonctions (les fameux besoins fondamentaux auxquels entend répondre la Charte d’Athènes), mais avait aussi une dimension spéculative, celle de communiquer le sens de ces divines proportions dont la contemplation (et non pas l’occupation) était empreinte d’une dimension mystagogique. Dans cette mesure, l’architecture allait devenir « l’art majeur », avant que les arts divers qu’elle abritait sous sa coupole ne cherchent à s’affranchir de son antique tutelle. En ce sens, l’architecture aura toujours été au moins autant spectacle, émotion, contemplation, « grand livre de l’humanité », ou image de la Cité Céleste qu’abri, fonction et art appliqué.
Il est notable que ce renversement des anciennes hiérarchies, cette affirmation des puissances de l’imaginaire ait lieu dans un temps qui (sur)valorise les réseaux et les espaces virtuels — lesquels ont fini par devenir cet objet de culte qu’avaient anticipé les Saint-Simoniens, et n’en finissent pas de modeler non seulement les lieux urbains (et la modernité n’est, en un sens, rien d’autre que l’aménagement réticulaire du territoire), mais aussi les milieux humains et les comportements au point que c’est l’espace public lui-même qui semble avoir migré sur les réseaux numériques.
Le réseau et le rond-point comme métaphore
Les réseaux avaient déjà en effet profondément bouleversé le territoire, mais il s’agissait des réseaux du premier âge industriel, dont se délectent aujourd’hui les artistes, soit que ces réseaux soient encore opérationnels (et ils le sont dans une mesure encore très importante — un beau travail consisterait d’ailleurs à affecter des marqueurs temporels sur la carte de tous ces réseaux que nous utilisions encore aujourd’hui, pour donner à la carte ainsi redéfinie, cette profondeur de temps qui lui fait défaut, sauf pour la nature et la géologie) soit, cas le plus fréquent, pour en archiver la mémoire à travers des dispositifs et objets monumentaux qui en conservent la trace (car ces témoins d’une industrie lourde sont au mieux promis à la reconversion — et il s’agit souvent d’une reconversion artistique —, au pire à la disparition ou à l’effacement dans les plis de la rurbanité galopante au-delà des frontières de la ville et même de ses banlieues).
Il est utile cependant de rappeler à quel point ces marques d’un paysage aujourd’hui révolu, auront su, et depuis longtemps déjà, accéder, dans certaines pages célèbres de Heidegger ou Simondon sur les ponts, les routes, les manufactures et autres marques paysagères de l’âge industriel, à une sorte de dignité esthétique, qui leur fut d’abord communément refusée. Ainsi, les artistes et les philosophes ont su libérer la pensée de la tutelle d’une antique esthétique du beau naturel, et montrer les beautés inaccoutumées du beau industriel (cela commence avec les impressionnistes, et les bords de la Seine, qui sont indissolublement le lieu d’une évolution des mœurs et d’une mutation des paysages — et qui voient s’élever de grandes cheminées, des ponts métalliques, des manufactures et entrepôts sur les quais du fleuve), construisant progressivement l’image d’un paysage organisé autour de quelques grands marqueurs datant du premier âge industriel et de sa gloire, aujourd’hui commués en lieux de mémoire (tel, par exemple, le Musée de la Mine de Saint-Étienne), ou encore survivant dans la mémoire par le traitement que leur applique certains artistes photographes (on pense évidemment ici aux châteaux d’eau et autres tours réfrigérées répertoriés et archivés par Bernd et Hilla Becher).
En ce sens, il y a un singulier du pluriel industriel, et cette singularité des dispositifs et sites où s’inventèrent à grande échelle les objets en série de la société de consommation (voitures, électroménager, chaussures, textiles), n’échappe pas aux gardiens de la mémoire et de l’épaisseur symbolique des choses. Qu’ils soient artistes, ou conservateurs en charge du patrimoine, l’industrie lourde et ses marques paysagères sont l’objet, qui doit beaucoup à la photographie, d’un savant travail d’inventaire, de conservation/reconversion, qui fait une part égale au divertissement et au culte. Cela nous conduit à penser que l’industrie, paradigme même de la répétition mécanique du même à l’échelle des marchés de masse, a aussi partie liée avec la singularité des lieux, des cultures et des territoires.
Que la reproduction vienne finalement en amont de la production et la poïésis, voilà une très vieille question, qui vient déranger à l’âge industriel les anciennes hiérarchies du majeur et du mineur, de l’art majuscule et des arts appliqués, et nous renvoie, pour la revisiter, à l’ancienne hiérarchie des arts mécaniques et des arts libéraux : les arts industriels, que l’on serait portés a priori à situer du côté des arts mineurs en tant qu’ils procèdent d’une forme d’utilitarisme et de reproductibilité, sont plus difficiles à catégoriser qu’il n’y parait a priori (et c’est tout le travail, sans cesse à reprendre, auquel invite le texte canonique de Benjamin consacré à cette question). Cette haute modernité industrielle, qui irradie partout dans un sens que l’on croyait être d’abord celui d’une neutralisation des lieux et des cultures singulières, est ainsi aujourd’hui l’objet d’une attention, presque d’une sacralisation, ou d’un culte, après avoir servi de repoussoir ambigu pour les artistes (ambigu, car les grands artistes du XXème ont toujours su négocier un rapport intelligent avec l’industrie, une relation faite de fascination et de répulsion, et réinventer l’art au cœur même de ce qui se donne a priori comme sa négation programmée — on pense ici à Duchamp ou Warhol, ou même Arman et César).
Certains artistes l’ont bien compris, et ont su tirer parti des matériaux industriels qui constituent le vocabulaire même de l’espace urbain moderne et industrialisé pour concevoir des œuvres dont la grammaire et le vocabulaire sont tirés de leur répertoire : Patrick Raynaud a ainsi conçu un Giratoire (6) qui trouve son principe dans l’un de ces lieux hautement problématiques dans l’imaginaire collectif des Français, et sans doute des Européens. Il s’agit du rond-point : la sculpture qu’il propose sur un de ces ronds-points est formée des panneaux de signalisation les plus divers qui composent notre code de la route et son système d’interdiction et d’orientation. Le rond-point s’est en effet imposé, à la fois soudainement et massivement, à l’ordre circulatoire et routier des Européens, sans prévenir de son arrivée, et est venu perturber un habitus inscrit dans les profondeurs de l’homo automobilis : la sacro-sainte priorité à droite. […/…]
Le rond-point est aujourd’hui assimilé par le corps social et peu sociable des automobilistes, comme une fatalité et comme une figure obligée de la circulation. Mais un problème subsistait, une fois le rond-point accepté dans son principe et reconnu dans ses vertus sécuritaires : son sens (le mot s’entendant aussi bien en termes de signification que d’orientation), ou si l’on veut ses qualités à la fois esthétiques, symboliques et sémiotiques (les objets d’orientation dans la ville et sur la terre ayant, on le sait depuis toujours, rempli de hautes fonctions symboliques, mais aussi esthétiques; et la signalétique urbaine a acquis, au cinéma ou même dans un certain hyperréalisme artistique, ses titres de gloire depuis bien longtemps déjà). Car la question s’est très vite et à juste titre posée de la profonde vacuité de ces cercles qui se succèdent en enfilade au fur et à mesure qu’on entre ou qu’on sort des modernes mégapoles […/…]. Le rond-point abolit le conflit de l’art et de la ville comme partage « dissensuel » du sensible, et il est patent que ces ronds-points sont devenus dans bien des cas le refuge de la haine de l’art, le réceptacle et l’exhibition d’œuvres monstrueuses qui sont supposées égayer la circulation.
Fluidité et mobilité : l’art à l’heure des nouveaux agencements mobiles et collectifs d’énonciation.
Le rond-point vaut donc comme métaphore de la fluidité voulue par le monde actuel, l’expression achevée de cette mobilité promue à la fois par les systèmes de transports et les systèmes de communication, et en particulier les réseaux et les nouvelles technologies, réseau dont ils seraient comme les nœuds. Cette fluidité et cette mobilité généralisées, tiennent, on l’a déjà souligné, à la dislocation des anciens régimes d’appartenance — foyer, famille, territoires ou quartiers —, à la puissance des « objets nomades » et des portables en particulier, au trafic incessant des images et à leur caractère flottant, au doute qui en résulte quant à leur vérité et à leur caractère de preuve.
Cela tient encore à l’empire contemporain du récit et de la fiction dans la gestion des affaires de la cité (comme le démontre l’emprise du storytelling dans le discours et la gestion de l’espace politique). La question se résumerait alors à cette formule lancée par Deleuze : que peut l’art encore quand c’est le monde qui fait son cinéma ?, et quand l’histoire tourne en rond comme les automobilistes autour d’une rond-point ? Quand, devrait-on ajouter, c’est le cinéma — au sens large d’un dispositif foucaldien fondé sur le temps et le mouvement qui environne l’environnement spatial même ? Mais un dispositif, qui par le biais des technologies numériques de toute nature qui convergent dans les rues de nos villes et à même nos corps, semble avoir étendu son emprise au battement artériel de la ville-monde tout entière.
Chacun peut constater la place grandissante des systèmes de contrôle optique et/ou de traçabilité biométrique (vidéo-surveillance, systèmes de vision panoptique comme Google Earth, ou encore cartographiques dynamiques accessibles via nos portables même, et déjà les puces RFID). Cette couche sans cesse plus dense de connexions télé-numériques a une première conséquence majeure (outre qu’elles se présentent de plus en plus sur un plan de saisie et d’enregistrement haptique et optique) : elle modèle, elle agence nos modes de vie, nos milieux et nos comportements à la fois individuels et collectifs à une échelle inégalée — qui va bien au-delà des échelles de ces micro-communautés virtuelles des « pionniers » du réseau, aujourd’hui largement dépassés par le flot et le flux des réseaux sociaux, et des apéros géants de Facebook. Elle est en passe de devenir l’espace public même (voyez l’importance acquise en quelques mois par les médias alternatifs en ligne, comme Mediapart ou Agoravox, et leur poids dans le débat politique), ou au moins le théâtre de ces « nouveaux agencements collectifs d’énonciation » que Félix Guattari appelait de ses vœux, et qui se réalisent aujourd’hui, mais selon des orientations bien différentes de celles que le philosophe avait en vue.
Elle a une deuxième conséquence : c’est qu’elle induit une mobilité et une portabilité généralisées qui sont désormais les vrais liants du ciment social, après (ou avant la télévision, si l’on résonne statistiquement sur les populations jeunes), et la moindre association disposant d’un site en ligne ne saurait se manifester sur la scène mondiale sans son réseau de liens connexes et de sites liés. Il en résulte, on le sait, d’insurmontables problèmes de régulation commerciale, territoriale, juridique, étant donné le caractère transfrontalier et ubiquitaire de ces technologies (ce problème est d’ailleurs au cœur de la discussion à propos de la numérisation du patrimoine littéraire de l’Europe, et au rôle qu’entend s’attribuer Google dans ce projet), etc.
Il en résulte aussi un constat facile à faire : c’est que si le virtuel n’abolit pas le réel, ou ne conduit pas à sa résolution dans l’éther du simulacre généralisé, la question des relations entre le virtuel et la réalité ne s’en pose pas moins d’une manière d’autant plus pressante que les technologies numériques et les réseaux ont aujourd’hui infiltré les lieux et les milieux humains aux dimensions des territoires et des espaces du collectif à une échelle massive : avec ces milliards d’utilisateurs de téléphones portables dans le monde actuel, la portabilité n’est plus du tout une affaire de connectés ou de spécialistes. Un autre aspect de cette évolution tient à son caractère fluide, liquide, indomptable comme une mer déchainée. Ces technologies ne sont jamais là où on les attendrait, et leurs usages, leur évolution, bien que parfaitement programmées dans les laboratoires, ne se réalisent jamais comme on le croyait : là où l’on attendait ceci, c’est cela qui vient et se déploie à la vitesse virale des rumeurs.
Il devient dès lors très difficile de tracer les lignes d’une évolution prévisible entre les arts contemporains et la ville d’aujourd’hui, tant sont diverses les figures et les formes qu’empruntent les expérimentations artistiques actuelles, elles-mêmes en résonance constante avec la pensée et la réalité de l’innovation technologique en révolution permanente : il est devenu évident que la vidéo-surveillance est désormais l’enjeu d’une esthétique et d’une « pragmatique » urbaines inédites, qui empruntent à la fois à l’esthétique surréaliste et à la dérive situationnistes. Et en effet, une bonne part des tentatives de l’art actuel s’inscrit en continuité avec les œuvres de certains « ouvroirs » d’espaces potentiels : on sait bien que l’esthétique de la modernité même ne serait rien sans le prédicat de la mobilité, du déplacement et du trajet, dans l’art comme dans la littérature — de Breton à Pérec en passant par Butor, Pasolini, Godard, Debord, ou Long —, rien n’aura eu lieu que le déplacement et le trajet comme métaphore et objet de toute quête esthétique ou poétique.
En ce sens, l’actuelle question de la mobilité ne fait que s’inscrire dans la continuité des engouements de l’avant-garde artistique et littéraire du siècle dernier, de même d’ailleurs que la recherche d’un couplage singulier, « hétérochronique » autant qu’hétérotopique, entre perception objective et perception subjective, entre individu et collectif. […/…] Dans un autre registre, certains artistes imaginent des œuvres relevant d’une catégorie inédite, et que je proposerais volontiers de qualifier d’œuvres augmentées (comme on parle de réalité augmentée à propos du virtuel), parce qu’elles réalisent une forme de couplage ou d’hybridation inédits entre l’espace urbain et le réseau. Ainsi, Sophie Calle a proposé en 2007 une œuvre intitulée www.transport-amoureux.vu, qu’elle a installée dans une station du tramway de Toulouse. La recension de cette œuvre dans l’ouvrage L’art à ciel ouvert, consacré à la commande publique, fait mention de celle-ci dans les termes suivants : l’œuvre de Sophie Calle illustre bien ce phénomène de couplage de l’écran d’ordinateur et de l’espace urbain dans cette commande publique. […/…]
Mais ce n’est pas non plus simplement d’un couplage qu’il s’agit — comme si les deux allaient ensemble dans une heureuse harmonie : il s’agit d’un renversement conflictuel de la hiérarchie des espaces, de la hiérarchie des formes du lieu et de l’espace public en général. Comme si désormais c’était l’écran de l’ordinateur et plus généralement le paradigme du réseau qui s’imposaient aux formes, aux apparences que devait prendre l’espace de la vie commune, et qui en modèlerait non seulement les signes, mais aussi l’architecture (ainsi depuis déjà longtemps de ce toit d’une école d’ingénieur de Marne-la-Vallée, qui est clairement l’agrandissement aux échelles d’un bâtiment, d’un écran d’ordinateur, à la manière de cette pince à linge qu’Oldenburg avait conçue, mais aux dimensions d’une sculpture destinée à prendre place dans les rues de New York ).
Le « terminal », dès lors, n’est en rien ce qui se trouve au terme d’un processus qui irait du réseau vers le récepteur ou l’internaute, du dehors collectif vers le dedans individuel. Dans une logique de maillage connexionniste du territoire et des réseaux, et de mise en relation complexe du public et du privé, le terminal est aussi bien la source, le moteur d’affiliation de la sphère publique à la sphère privée et de la sphère privée vers la sphère publique (avec les webcams par exemple) — et c’est un fait d’importance majeure que les appareils télé-numériques se présentent de plus en plus comme des outils de saisie ou d’enregistrement, mais aussi de lecture et de projection (et même de transfert et d’échange entre projections à usage collectif sur des murs d’immeubles et usage individuel sur des téléphones portables). L’œuvre de Sophie Calle exemplifierait en ce sens un concept qu’un chercheur en sciences de la communication, Dominique Boullier, a récemment proposé pour qualifier l’évolution des relations entre le dedans et le dehors, l’individuel et le collectif, le privé et le public. Il s’agit de l’habitèle. Contrairement à la bulle (de Sloterdijk), l’habitèle implique un couplage du sujet avec son environnement par le biais d’interfaces.
Un autre exemple de ce couplage de l’espace urbain et du mobile, l’installation de l’artiste JR sur les quais de Seine : un système de street audioguide permet aux passants de composer sur leur portable un numéro gratuit pour entendre les interviews et le récit de la vie des femmes qui sont présentées sur des photos de grand format. Certaines de ces applications combinent les technologies de géolocalisation et de réalité augmentée dans un système équipé d’une caméra, d’un récepteur GPS et d’un accéléromètre capable de reconnaître le lieu et l’orientation de l’usager lui permettant ainsi de visualiser à l’écran un espace « augmenté », par la superposition visuelle de contenus.
Ce qui se dégage de l’analyse sommaire des propositions récentes ayant pour objet ces agencements rythmiques d’énonciation de l’œuvre d’art et de la ville, c’est de manière récurrente, la tentative d’articuler le corps social, collectif et la perception singulière des individus, de mettre en résonance contradictoire, en conflit et en relation, perception subjective et décryptage/analyse automatisés du réel, grâce aux dispositifs d’enregistrement et de traçabilité, mais aussi de mesure, de cartographie et d’orientation qui constituent désormais le cadre flottant de nos déplacements et de nos comportements. Comment nos attitudes peuvent-elles dès lors prendre forme, au-delà de la dialectique de l’éphémère et du pérenne, du l’objet et du modèle, de l’œuvre et du lieu, telle que la modernité et même les dernières avant-gardes les ont consacrés dans l’art et le paysage urbain ? Quelle forme l’art contemporain peut-il donner à ce flux continu, cet enchevêtrement de réseaux et d’espaces-temps asynchrones avec lequel nous sommes désormais obligés de composer pour habiter le monde ? Et « habiter le monde en poète » (exigence qui est encore celle d’un Guy Debord), cela se peut-il encore aux conditions de la mobilité et de la portabilité exigée par notre temps ?
À rebours de cette solution de continuité entre le monde réel et le monde des images prophétisée par les apôtres du simulacre, certaines œuvres se présentent dès lors comme des dispositifs asynchrones, ménageant des effets de rupture, des sautes de rythmes dans la relation entre l’espace perçu et l’espace réel dans lequel évolue le spectateur. C’est par exemple le cas avec Massmon Fujihata lorsqu’il travaille les données collectées lors de l’ascension du Mont Fuji de façon à en construire une image déformée en fonction de la vitesse de la marche. Les technologies immersives sont donc ici les vecteurs d’un usage situé à l’opposé de celui auquel les destine leur appropriation culturelle convenue, dans l’idéologie couramment entretenue de l’immersion et de l’interaction : elles apparaissent moins comme la promesse d’une continuité entre le réel et le virtuel, dont l’image viendrait en somme réaliser l’avènement avec la popularisation de la 3D, que comme une anacoluthe dans le discours dominant de l’industrie culturelle qui postule la continuité du réel et de la fiction moyennant un usage de plus massif et démocratisé de la 3D et du principe d’immersion, un accroc dans le tissu de la globalisation culturelle.
L’œuvre d’art contemporaine qui se destine à l’espace public apparaît ainsi de plus en plus traversée et modelée par le paradigme du temps et le conflit des régimes de temporalité actuels, à la fois calculables au plus haut point (ainsi le concept de life time value, qui indexe les possibilités d’une vie humaine sur des durées calculées en fonction de différents critères tels que l’éducation, l’hérédité, la santé, etc.) et fondamentalement incontrôlables (certains experts de la Silicon Valley prévoient même avec la théorie dite de la « singularité », la perte définitive du contrôle des machines par les humains aux alentours des années 2040). Œuvres qui viennent comme en compensation de cette calculabilité généralisée dans laquelle certains voient le destin de l’humanité se résoudre, se rétracter, si l’on ose dire, en une sorte de « téléologie négative » ou sans emploi.
Il n’y a d’ailleurs pas nécessairement de contradiction entre ces deux dimensions de la temporalité : soit l’idée d’un temps qui emporte tout sur son passage et règle les rythmes de chacun sur une sorte d’horloge collective qui tournerait selon le modèle des sociétés d’insectes (canalisant toute expression arythmique ou asynchrone des individus dans la majesté et l’évidence de son propre flux : ce serait là le modèle des freeways californiennes décrites par Baudrillard dans son beau récit — mais un récit désenchanté aussi — de voyage en Amérique (8)), soit au contraire l’idée que chaque être humain particulier se ferait l’inventeur, à travers la complexification croissante des grilles horaires, des emplois du temps, et de la réduction du temps de travail, ou la délinéarisation des flux télévisuels, de sa propre horloge biotechnologique et culturelle. Tel qui roule dans son automobile est ainsi à l’écoute d’un autre monde, plongé dans la profondeur immémoriale de sa culture d’origine (Arjun Appadurai a bien vu cet enchevêtrement des ethnoscapes et des médiascapes à propos des chauffeurs de taxi indiens à New York, dont la diaspora constitue une réalité politique qui a son poids, y compris en Inde même).
C’est là le modèle de certaines œuvres produites sur le mode éphémère comme des scénarios ou des actions scénarisées, qui ne visent à rien moins qu’à ouvrir à la multitude la possibilité d’une expérience singulière du récit, voire du micro-récit — là où domine globalement aujourd’hui l’impossibilité pour les êtres humains de porter librement la parole et le récit de leur expérience propre dans un échange intra-communautaire (encore que certains blogs invitent à relativiser cette assertion), ou alors sous la forme exhibitionniste et artificielle de la téléréalité (9). Ainsi, de cette expérience .walk relatée à nouveau lors du symposium des arts électroniques ISEA de septembre 2010. Au festival Transmediale de Berlin en 2004, ce projet de locative media intitulé .walk (« dotwalk ») avait reçu une mention honorable pour la prestigieuse compétition des « software awards ». Développé par un collectif artistique d’Utrech, Social Fiction, .walk combinait le code informatique et l’exploration urbaine « psychogéographique ». Selon certains observateurs, le succès de ce simple projet est représentatif d’un événement plus important qui prend place dans le monde des arts médiatiques, dans lequel, laissant derrière eux le net art, les locative media s’échappent des frontières de l’écran pour entrer dans la ville. […/…]
Ce que l’on peut dire, c’est que l’art des locative media réalise une forme de convergence entre l’art numérique et l’art urbain. Mais du même coup, il contribue à déstabiliser et l’un et l’autre, voire à la possibilité de leur dépassement à venir ou de leur résolution dans quelque chose d’autre, qui serait comme un art des lieux affranchi de l’opposition du local et du global, un art de la globalisation si l’on veut ; en ce sens, il participe de cette exigence que souligne Grégory Chatonsky, de penser la relation art/technique au-delà du malentendu dans lequel elle s’inscrit depuis toujours par cette double instrumentalisation qu’il dénonce — et en effet , tous ces projets participent de l’idée que l’ordinateur est un écran qui ouvre vers le monde du dehors, et au fond que ses usages artistiques antérieurs tels que le net art seraient dépassés.
Et en effet, l’art des lieux participe d’un processus ancien et continu de délocalisation et de « mobilisation » : du temple vers les haut-lieux sacrés, des hauts lieux vers les lieux du profane, tels les parcs ou les jardins, les monuments ou les places publiques, jusqu’aux lieux en déshérence, aux quartiers abandonnés, ou encore vers les lieux en mouvement que sont les lignes de tramway ou de métro, quand ce ne sont pas les non-lieux que les artistes élèvent alors en les occupant à la dimension d’un « vrai » lieu. Ce qui est en jeu dans un tel processus, c’est, comme l’ont souligné de nombreux commentateurs, la progressive montée en puissance des arts du temps et du rythme dans les arts du volume et de l’espace, à travers l’usage de plus en plus fréquent du son dans de nombreuses installations, mais aussi de l’image animée, ou encore du récit et de la fiction tels qu’ils s’énoncent le long des lignes de tramways ou d’autres formes-trajets.
Mais l’art numérique est lui aussi, on l’a vu, confronté à la nécessité de son propre dépassement, et celui-ci se réalise en effet à travers son intégration progressive au « champ classique de l’art », ou alors à son assimilation plus ou moins conflictuelle au monde contemporain du business, et en particulier du business des cultures numériques. À ces réserves près, on peut dire que ce qui rassemble les œuvres ici évoquées, c’est d’abord qu’elles participent d’un modèle systémique ou systématique de mise en œuvre, qui témoigne de leur filiation avec les littératures à contraintes. Elles fonctionnent comme un système ouvert, mais qui repose sur le postulat d’une grille d’analyse, de lecture, un opérateur ou un embrayeur de mise en œuvre, qui trouve son modèle dans les sciences du contrôle, de la régulation, ou de la planification, comme la cybernétique, la systémique ou la cartographie (ce qui ne pas sans reposer l’éternelle question, surtout s’agissant d’une nouvelle version de la poétique de la ville fondée pour une bonne part sur des techniques de traçabilité, de l’équilibre instable du contrôle et de la liberté).
En conjuguant le réel et sa représentation selon un modèle qui intègre la représentation et la trace au corps même de l’expérience, ces pratiques s’inscrivent dans une filiation littéraire à laquelle on peut aussi associer Stendhal (qui dans ses Souvenirs d’égotisme, dessine les plans des lieux auxquels il lui a été donné de vivre telle ou telle expérience), mais aussi bien sûr Perec ou, comme on l’a vu, les situationnistes — mais c’est alors d’une « pyschogéographie générative » qu’il s’agirait. Un aspect important tient à l’économie des moyens narratifs qu’elles sollicitent ou qu’elles produisent. Jean-Louis Boissier remarque à ce propos la filiation de ces expérimentations avec les schifters dont Barthes avait dans un beau texte évoqué les qualités poétiques éventuelles, telles qu’elles s’expriment dans les énoncés brefs des cartes postales, et dont les actuels SMS offrent une nouvelle version. C’est une même économie de moyens que vise Sophie Calle quand, à propos de son œuvre transports-amoureux.vu, elle déclare aimer le style économique, concis et poétique des messages que l’on trouve dans la presse quand les gens souhaitent se retrouver.
Ensuite, c’est qu’elles procèdent d’un feuilletage du réel, qui se présente en couches, en strates, en cartes dynamiques superposées, ou plans constituant autant de points de vue fragmentaires qui se superposent et s’additionnent à propos d’un site, d’une forme-trajet, d’un « entour », plus qu’ils ne servent à y projeter l’objet perçu dans sa totalité. Elles réalisent en un sens le dépassement de l’opposition entre la vison en surplomb et l’expérience, et la vison trajective comme expérience concrète du lieu et de l’espace, au profit d’un espace dont le modèle serait la vision panoramique telle que l’envisage Bruno Latour (pour Latour, le panorama n’est pas un point de vue surplombant, et extérieur aux autres visions possibles vues d’en bas, à même la ville, il réalise seulement un plus grand nombre de connexions entre les différentes visions possibles, dont il fait lui-même partie, mais à un degré supérieur de synthèse (12)).
Mais il n’est pas possible d’épuiser l’ensemble des points de vue possible à partir de mon champ de vision, et c’est avec une totalité ouverte qu’il me faut composer, une totalité qui ne serait pas tant la somme des parties qu’une partie additionnelle — car il existe toujours la possibilité non seulement d’un point de vue qui m’échappe, mais aussi d’un point de vue à partir duquel c’est une autre réalité qui se dessine dans mon champ de vision : si bien que le « moteur », si j’ose dire de la représentation, ce n’est pas l’œil et l’optique projective de la Renaissance, mais le mouvement et le déplacement, dans des espaces simultanément ou alternativement vécus concrètement et représentés/enregistrés « abstraitement ». Et donc, un troisième trait significatif de cette esthétique du déplacement, c’est qu’elle relève d’un espace de collage ou de recollement, plutôt que d’un espace de projection, espace que Deleuze et Guattari anticipèrent, à travers leur idée du corps sans organe.
En tous ces sens, on serait enclin à penser que c’est finalement le cinéma qui constitue le modèle de cette évolution — mais un cinéma en devenir permanent et dont le centre de gravité est indissolublement situé en arrière-plan de notre temps, du côté de la vieille modernité, et en propulsion vers l’avenir, dans son alliance en cours de réalisation avec le réseau, un cinéma-réseau qui traverse déjà de part en part le processus en cours d’éditorialisation artistique de la ville. Mais cinéma, dès lors, s’entendant en divers sens qu’il faudrait approfondir : à la fois dans le sens du cinéma « installé » de l’art contemporain, et le cinéma délocalisé et comme réticularisé d’aujourd’hui, s’il est vrai que le cinéma s’est lui-même affranchi de la salle obscure qui faisait corps avec son histoire et sa mémoire, et s’est ouvert à des modes de diffusion, des supports et des lieux de plus en plus nombreux et interconnectés (c’est ce dont témoigne en particulier une manifestation comme le Festival des 4 écrans, initié par Hervé Chabalier, et qui repose sur l’idée de repenser la question de l’écran dans sa démultiplication même, entre cinéma, télévision, ordinateur et Smartphone — et les effets qui en résultent quant à la création cinématographique elle-même — dont la multiplication des manifestations et festivals de cinéma consacrés aux très courts formats serait le symptôme (13).
Il ne faut pas non plus oublier la multiplication des projections dans la ville même, la salle obscure s’extériorisant alors dans la vraie vie qui fait son cinéma — non plus d’ailleurs que l’avènement prochain du 5ème écran, qui réalise la fusion du cinéma interactif et des appareils télénumériques de connexion : le 5ème écran comme opérateur d’agencements inédits et interactifs du collectif et de l’individuel dans l’espace urbain, selon une logique de traitement de l’information qui ouvre de réelles perspectives à cette transindividuation qui fait défaut dans l’espace public de nos sociétés (rappelons que la transindividuation chez Simondon, c’est cette invention réciproque du sujet dans sa relation aux autres, à travers les mécanismes d’appropriation et de transformation des schèmes et des objets, en particulier techniques, qui évoluent eux-mêmes à travers ces processus d’échanges individuels et collectifs. Bernard Stiegler a repris ce thème en s’appuyant sur l’exemple de la langue, qui illustre parfaitement ce processus (14) : en effet, dans le cas de la langue, le je et le nous se construisent réciproquement à travers ces jeux complexes de projection et d’appropriation, de locution et d’interlocution, qui ne peuvent exactement se prédire, mais seulement se constater, et s’enregistrer dans un usage de plus en plus intensif qu’en font les uns et les autres; mots et vocables inouïs dans la « société » desquels les hommes se vivent de plus en plus, jusqu’au point où les académiciens ne peuvent ensuite que consacrer cet usage dans le dictionnaire, quand ces mots, comme disaient les classiques, finissent par « faire société ».
Mais aussi du cinéma « augmenté », dans tous les sens que cet adjectif est susceptible de prendre aujourd’hui, à la fois celui de cette montée des simulacres qui forme l’arrière-plan de la pensée critique moderne, de Baudrillard à Jacinto Ligeira, et celui de l’essor de ces villes-fiction, qui de Las Vegas à Dubaï apparaissent comme une expansion fictionnelle du monde, entre artifice et fiction. Et dans le sens enfin du cinéma entendu comme cet art industriel qui se déplace sans cesse sur la frontière entre art et non-art — ainsi que le fait l’art des locative media, qui emprunte à la fois à plusieurs arts, et entend parfois s’affranchir du champ classique de l’art. Et aux yeux des acteurs du monde des locative media, il est question, je cite, non seulement d’un changement de paradigme dans le monde de l’art, mais aussi d’une reconfiguration de notre vie quotidienne dans le sens du renouvellement de notre place dans le monde.
Le réel c’est ce qui fait trou, disait Lacan. Face à cela, le codage d’un même espace vu selon des points de vue différents porte peut-être la chance d’une autre aventure dans la réalité de la ville même, et d’une autre relation entre l’art et la ville — d’une prise et d’une « reprise » artistique dans le tissu urbain, à travers le jeu des vrais et faux raccords entre tous ces points de vue, avec la part de contingence et de « bruit » fatal qui en résulte, et qui seraient, pour reprendre la formule de Duchamp, comme leur commun coefficient d’art. Un art improbable encore, « fait par tous, non par un ».
Norbert Hillaire
publié dans MCD #73, « La numérisation du monde », janv. / avril 2014
Norbert Hillaire est professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis où il dirige le master « ingénierie de la création multimédia ». Théoricien et artiste, il s’est imposé comme l’un des initiateurs de la réflexion sur les arts et les technologies numériques, à travers de nombreuses publications, directions d’ouvrages et missions prospectives pour de grandes institutions (ministère de la Culture, Centre Pompidou, Datar). Son ouvrage, coécrit avec Edmond Couchot, L’art numérique : comment la technologie vient au monde de l’art (Flammarion, 2003), fait aujourd’hui référence. Comme artiste, ses photomobiles interrogent les relations entre peinture, photographie et cinéma et sont régulièrement exposées en France et à l’étranger

(1) On lira avec profit à ce sujet l’ouvrage de Jacinto Lageira, La déréalisation du monde : réalité et fiction en conflit, Jacqueline Chambon, 2010.
(2) Voir Thierry Paquot et Chris Younès (Dir), Philosophie de l’environnement et milieux urbains, La Découverte, 2010.
(3) « Contours et alentours », in Œuvre et Lieu, dir. Norbert Hillaire et Anne-Marie Charbonneaux, Flammarion, 2002
(4) Le document de présentation de l’œuvre rappelle l’histoire de la Biennale de Venise et nous enseigne qu’en 1938, les nazis avaient radicalement transformé ce petit hall consacré à l’art selon leurs conceptions architecturales. Ils en firent un bâtiment néoclassique à la façade sévère et rébarbative. En 1964, un réaménagement de l’intérieur a atténué le caractère autoritaire de son architecture. Mais le faire complètement disparaître aurait signifié la destruction du pavillon pour en construire un autre. Or le bâtiment a été classé monument historique. Il représente donc un défi pour les artistes qui y exposent. Quiconque aménage le pavillon allemand — qui jouit du soutien du ministère fédéral des Affaires étrangères — livre aussi automatiquement un commentaire sur l’histoire de l’édifice.
(5) Voir Patrice Maniglier, La perspective du diable, Figurations de l’espace et philosophie de la Renaissance à Rosemary’s Baby, Actes Sud/Villa Arson, 2010. L’auteur développe son analyse à partir de l’œuvre proposée par Laetitia Delafontaine et Gregory Niel, qui se présente comme un duo d’artistes-architectes.
(6) Patrick Raynaud, Giratoire, 1989. Les panneaux indiquent une quarantaine de noms de villes où l’artiste a exposé. Rond-point de Vuers, Villeurbanne.
(7) Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, 1992.
(8) Jean Baudrillard, Amérique, Grasset, 1986.
(9) Ou encore sous la forme de ces albums de voyage préconçus dans les nombreuses applications informatiques de nos ordinateurs comme de simples archives familiales à usage strictement privé. Fictions photographiques et récits largement contenus dans les limites de cet ordre narratif surplombant dont le storytelling offre le modèle, mais dont la fiction des parcs de loisirs et même des méga-parcs de loisirs du genre de ceux qui se construisent à Dubaï fournissent un aperçu encore plus spectaculaire.
(10) Mobilisable : nom d’une manifestation qui regroupe L’Ensad (EnsadLab), en coopération avec l’Université Paris 8 (laboratoire Esthétique des nouveaux médias) et l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, avec le concours la Haute école d’art et de design de Genève (laboratoire Formes de l’interactivité) et de l’University of the Arts in Tokyo (Graduate School of Film and New Media), autour des mutations artistiques qu’impliquent les médias du déplacement et de la localisation, l’émergence du paysage technologique, les nouvelles formes de cartographie et de récit, les nouvelles modalités de la dialectique mobile-immobile, les nouveaux instruments de l’exercice de la mobilité. Le terme mobilisable qualifie alors des formes artistiques et des œuvres, mais aussi de possibles comportements des artistes et du public, de la collectivité engagée dans de tels processus artistiques, scientifiques et culturels.
(11) Grégory Chatonsky, « dialectiques de la singularité de l’art numérique », www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/10/13/art-numerique-description-12/#more-2896
(12) Voir : www.bruno-latour.fr/virtual/PARIS-INVISIBLE-GB.pdf
(13) Voir : www.festival-4ecrans.eu
(14) Voir Bernard Stiegler, « Entreprendre autrement : pour refonder la société comme « milieu associé », in L’Artiste et l’entrepreneur
(dir. Norbert Hillaire), Cité du Design Editions, 2008.